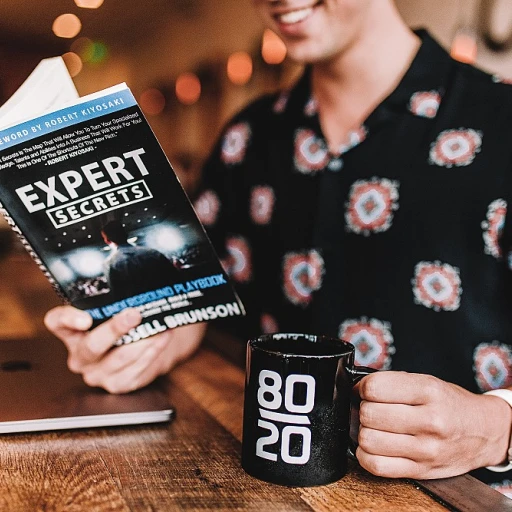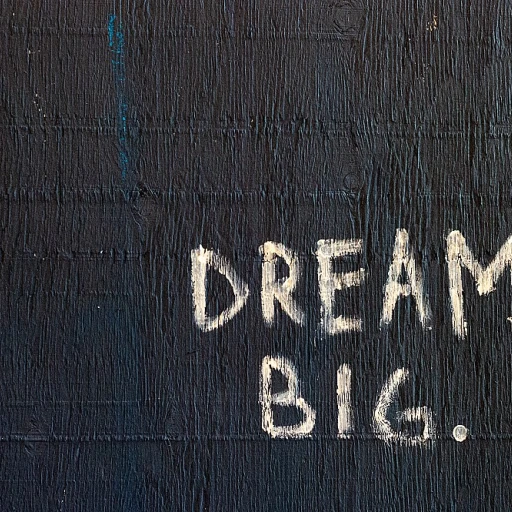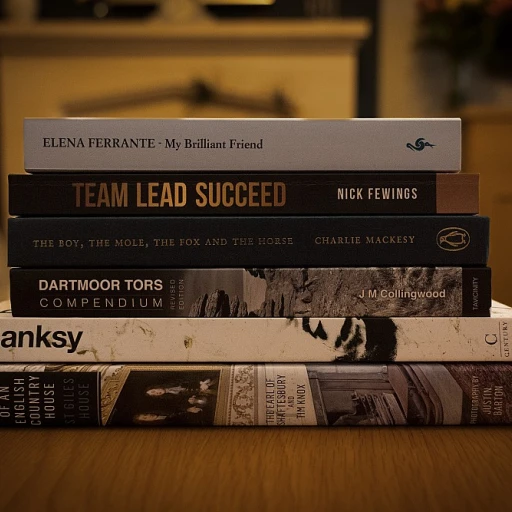Madame Costedoat-Lamarque, comment définissez-vous les biais cognitifs et les dynamiques inconscientes dans le contexte de la culture d'entreprise, et pourquoi pensez-vous qu'ils sont souvent négligés dans les approches traditionnelles de transformation?
Notre système éducatif est très rationnel. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes habitués à baser nos jugements et actes sur ce que nous observons et sur ce que nous en déduisons d’un point de vue logique. Cela restreint le champ de ce que nous prenons en compte. Ainsi, la culture d’entreprise est à la fois rationnelle car elle permet des processus assurant la cohésion de l’organisation, et non rationnelle car elle induit des comportements inconscients qui stigmatisent ceux qui sortent du rang (puisqu’inconsciemment c’est un risque pour la cohésion donc la survie de l’organisation). Prendre conscience de ces dynamiques inconscientes est à la fois inconfortable et difficile, il est donc plus aisé de ne pas s’en occuper et de lancer une opération de communication ou de formation pour accompagner une transformation.
Votre méthode I·SEE vise à transformer les organisations en agissant sur des leviers invisibles. Pourriez-vous expliquer comment cette méthode peut aider à surmonter la crise du sens au travail et la défiance envers les décideurs?
Crise du sens et défiance trouvent, notamment, leur source dans le fait que les salariés ne sont souvent pas directement partie prenante de la transformation. C’est une forme d’infantilisation que de leur dire ce qu’il doit faire et comment le faire. Le modèle I·SEE permet de poser le cadre stratégique et non négociable de la transformation, tout en impliquant les parties prenantes dans sa mise en œuvre. Il fait émerger les modes de fonctionnement sous-jacents qui souvent viennent générer des résistances au changement, permettant ainsi de s’ajuster pour générer de l’engagement.
Comment vos expériences personnelles vous ont-elles menée à développer un intérêt pour l'inconscient du système dans le monde du travail, et quel a été le déclic pour créer ‘Agir sur les leviers invisibles’?
J’ai découvert C.G. Jung en 2009 lorsque je me suis formée à HEC Executive coaching, et cela m’a donné envie d’expérimenter ses concepts, dont l’inconscient, les synchronicités, l’Ombre. Il m’est rapidement apparu évident que ce qui se jouait au niveau individuel s’appliquait également au niveau collectif. Etant Responsable de l’accompagnement du changement pour l’entité spatiale d’Airbus, cela m’a permis de confirmer, en grandeur nature, ce que j’avais pressenti. La pertinence de la prise en compte de l’inconscient du système est aujourd’hui une telle évidence dans ma vie personnelle et professionnelle que j’ai voulu transmettre ce regard décalé au plus grand nombre, pour augmenter le niveau de conscience et de compréhension des systèmes (individus, équipes, organisations) et donner des moyens d’action opérationnels.
Le leadership systémique que vous proposez met l'accent sur la transformation personnelle. Pourriez-vous partager un exemple où un leader a réussi une telle transformation et quel impact cela a eu sur leur organisation?
La transformation personnelle ne se « réussit » pas dans l’absolu. C’est un processus continu et engageant intérieurement. J’ai le plaisir d’accompagner un directeur général (et son équipe) qui porte très fortement des ambitions de transformation pour son organisation. Cela le pousse à revoir son positionnement en tant que leader, à être challengé, à reconfigurer certaines de ses activités. C’est parce qu’il chemine lui-même en toute transparence que ses équipes, voyant les résultats, sont enclines à avancer sur ce même parcours. C’est la puissance de l’exemplarité portée par le sens.
Dans le cadre de la transformation organisationnelle, quelle est la place de la spiritualité et des émotions refoulées selon vous, et comment ces éléments peuvent-ils être intégrés sans heurter la sensibilité des employés?
Teilhard de Chardin disait « nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine ». Pourtant, le sujet de la spiritualité reste tabou dans le monde de l’entreprise en particulier. J’en ai une approche très pragmatique. Chacun de nous, que nous le voulions ou non, fait partie de quelque chose de plus grand, d’un système plus large (notre famille, notre pays, notre monde, etc). Ne pas prendre cela en compte revient à avancer sur son chemin (en tant qu’individu et en tant qu’organisation) en ne regardant que le bout de ses chaussures. Bien dommage. Il en est de même pour les émotions, qui sont refoulées simplement car beaucoup ne savent pas les « gérer », ou les prendre en compte. Elles sont pourtant une superbe source d’information.
Emotions et spiritualité sont des leviers pragmatiques et pertinents à prendre en compte pour qui veut transformer, car elles nous reconnectent au sens et à ce que nous sommes profondément.
Les neuroatypiques sont souvent mis à l'écart dans les organisations. Comment votre approche systémique peut-elle aider à mieux intégrer ces individus et à valoriser leur potentiel unique?
Chaque salarié a un potentiel unique. Concernant les neuroatypiques, ils posent souvent problème car leur mode de raisonnement et de fonctionnement va à l’encontre des modes de fonctionnement implicitement agréés et donc confortables pour le plus grand nombre : trop de questions, trop d’idées, trop d’énergie, trop de recherche de sens par exemple. Là intervient à nouveau l’intérêt de la transformation personnelle du leader : un dirigeant dans cette démarche ne se sentira pas remis en question et s’appuiera sur le potentiel que ces salariés « décalés » représente. Chaque élément du système (dans une équipe ou une organisation) a une voix spécifique qui doit être entendue pour que la transformation globale puisse prendre forme.
Pour les sceptiques qui sous-estiment le pouvoir des leviers invisibles, quels arguments leur donneriez-vous pour les convaincre de leur importance dans la réussite d’une transformation organisationnelle?
Je suggère à ces sceptiques de ne pas me croire, mais d’expérimenter par eux-mêmes une transformation en mode « classique », très top-down, et de comparer avec une approche plus systémique et collaborative. A très court terme, il est possible de se leurrer mais à court et moyen terme, l’implication et l’état des équipes (donc la performance) ne trompe pas.
Pour en savoir plus : https://be-change-live.com/